
Monde-Diplomatique.fr
La gauche française, quand elle n’occupe ni Matignon ni l’Elysée, analyse plus volontiers son exercice du pouvoir. Depuis 2002, on ne compte donc plus les acteurs directs des septennats de François Mitterrand ou du gouvernement de M. Lionel Jospin qui ont rédigé des ouvrages de Mémoires et d’analyse. Que nous ont appris MM. Jospin, Pierre Mauroy, Jacques Delors, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Attali, Michel Rocard, Pierre Moscovici, François Hollande, Roland Dumas sur les quinze années de gouvernements socialistes, que nous ne sachions déjà ?
Au moins ceci : leurs talents de mémorialiste ou d’analyste sont inégaux. L’agrément de la lecture ou le brio de l’exposé ne constituent pas la qualité principale du livre de M. Mauroy, trop soucieux de rappeler au lecteur les moments où une foule l’ovationnait, et de célébrer par le menu son bilan municipal à Lille, ni de celui de M. Delors, détaillant le contexte et le contenu de divers Livres blancs européens. L’ampleur des révélations et la témérité autocritique ne caractérisent pas non plus l’ouvrage de M. Jospin. Mais s’informer n’est pas toujours se divertir…
La sempiternelle question des revirements de la gauche, celle aussi de sa droitisation liée aux « contraintes européennes », au bouleversement de sa sociologie électorale, sont indissociables d’une réflexion sur l’exercice monarchique du pouvoir. Il transforma le Parti socialiste (PS) en théâtre d’ombres où on s’affronte beaucoup, mais plus souvent sur les personnes que sur le fond des politiques (le congrès de Rennes de 1990, qui vit l’affrontement violent de deux mitterrandistes, MM. Jospin et Fabius, demeurera un modèle du genre), et il métamorphosa ses militants en supporteurs d’une écurie présidentielle, voire en porteurs d’eau des derniers arbitrages de l’exécutif (1).
« Très vite, indique M. Rocard, je me suis rendu compte que cette phrase de Mitterrand était une description exacte de la réalité : “Il n’y a pas de Parti socialiste, il n’y a que les amis de François Mitterrand.” » Or l’homme était « étranger à toute notion de formation politique, à la notion de parti. (…) Il n’associe jamais personne à rien ».
Sur ce point au moins, qui n’est pas mince dans la mesure où des choix fondamentaux pour la gauche (le « tournant de la rigueur » de 1983 en particulier) dépendirent d’un petit groupe et furent parfois tranchés par un seul, chacun semble s’accorder. M. Mauroy évoque, chez le président qu’il a servi, « le goût pour des opérations de “commando”. (…) Selon lui, pour réussir la rénovation de la gauche, il n’était nécessaire que d’une centaine d’hommes et de femmes décidés, solidaires, ayant confiance les uns dans les autres. Je m’étais senti prêt à être l’un de ces cent-là ! ».
Cette personnalisation de la politique, puissamment encouragée par les médias, les sondages, la pente présidentialiste des institutions (laquelle fut, ainsi que le rappelle M. Moscovici, accrue par l’inversion du calendrier électoral décidée en novembre 2000 par M. Jospin sans que ses ministres soient consultés…), se retrouve dans l’actuelle campagne électorale. Les plates-formes des partis paraissent avoir pour principale fonction de permettre aux candidats de signifier leur majesté en négligeant ce qu’elles prévoient. « Si on ne désacralise pas la fonction présidentielle, on ne rétablira pas la fonction démocratique », avertit néanmoins M. Hollande. Mitterrand, déjà, avait beaucoup déclamé ce discours-là avant de s’épanouir dans toutes les protubérances de l’exercice solitaire du pouvoir.
Compte tenu de son profil « girondin » et des épreuves qu’il endura à Matignon, le verdict institutionnel de M. Rocard est plus inattendu : « Ma conclusion est que, finalement, la Ve République nous a donné des institutions stables qui ont aidé à restaurer le prestige national, et permis une stabilité institutionnelle très inhabituelle en France. Tout ça fait soixante millions d’heureux et un malheureux, le premier ministre. C’est une proportion statistique honnête. Ce qui me conduit à penser que, même si elle est imparfaite, je crois préférable de ne pas toucher à la Constitution. »
Deux gauches. Qui ignore encore le cliché médiatique à ce sujet ? D’un côté – avec le Parti communiste, M. Chevènement, le Fabius d’après 2005 – une première gauche incantatoire, protectionniste, autoritaire, archaïque. De l’autre – avec MM. Rocard, Delors, Dominique Strauss-Kahn, le Mitterrand d’après 1983 –, une deuxième gauche réaliste, européenne (ou « américaine »), démocratique, moderne, somme toute assez compatible avec la « troisième voie » dont se réclame M. François Bayrou (2).
Revenant sur les Assises du socialisme qui, en 1974, virent les amis de M. Rocard adhérer au parti de Mitterrand, M. Chevènement estime qu’alors « naquit la “deuxième gauche”, cocktail de “réalisme économique”, d’anticommunisme rénové et d’esprit social-chrétien, avec un zeste de bonne conscience anticolonialiste à retardement ». L’ancien ministre ajoute que Mitterrand, qui « vouait aux gémonies » le courant intellectuel incarné par M. Rocard et par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), en a « repris tous les choix ». Au point que, une fois acquis le virage de la « rigueur » financière, « cette lutte titanesque ne concerna plus que les initiés ».
Lire M. Rocard permet néanmoins de comprendre que l’alignement du président sur les idées néolibérales de son rival ne solda nullement leurs anciennes querelles. Entre 1988 et 1991, par exemple, Mitterrand n’eut de cesse d’imputer à la mauvaise exécution de son premier ministre les conséquences malheureuses de choix pourtant entérinés à l’Elysée. Selon M. Attali, il était « persuadé que Michel Rocard, le plus populaire des socialistes, avait un tempérament trop minoritaire, trop sectaire, pour réussir ». Et qu’il « n’avait pas le caractère nécessaire pour exercer la présidence ».
François Mitterrand :
« Je n’ai pas été élu pour privatiser
et enrichir les capitalistes ! »
Ainsi s’expliquent certains jugements présidentiels : « Il n’y a rien de pire que les socialistes qui rêvent de se voir décerner des brevets de bons économistes par des hommes de droite. Ils finissent par oublier qu’il sont de gauche. (…) Je n’ai pas été élu pour privatiser et enrichir les capitalistes ! C’est pourtant, objectivement, ce que fait ce gouvernement avec une ténacité que récompensent les sondages. » Le limogeage en 1991 du héros de la deuxième gauche ne modifia toutefois en rien la donne pour les « capitalistes ». L’année suivante, Pierre Bérégovoy, alors ministre (très mitterrandiste) de l’économie et des finances, allait jusqu’à s’en prendre aux conservateurs d’outre-Rhin, incapables selon lui d’éviter un « dérapage salarial en Allemagne (3) »… Vu qu’en 1981 les socialistes français reprochaient encore aux sociaux-démocrates allemands de trop céder au capitalisme, M. Delors est fondé à se réjouir : « Les idées de la deuxième gauche ont fini par pénétrer le PS. »
Brouillé aujourd’hui par les méandres que les calculs politiques ont imprimés aux convictions, l’enjeu de l’affrontement entre les deux gauches ne fut pourtant pas mince. Pour M. Chevènement, qui joua un rôle-clé dans la définition des engagements pris par les socialistes en 1981 (4), « la critique du scientisme, forcément borné, du progrès, inévitablement mécanique, de l’autorité, toujours arbitraire, du patriarcat, à coup sûr traditionnel, ne manquait pas de quelques justifications, mais elle occulta le grand renversement du rapport des forces sociales au détriment des salariés, qui a commencé en France en 1974 et que l’arrivée de la gauche au pouvoir, dans les années 1980, n’a pas substantiellement modifié ».
La mise en avant de thèmes culturels, « sociétaux », écologistes, communautaires, a-t-elle coïncidé avec la mise en bière du combat égalitaire, ou l’a-t-elle consciemment favorisée ? A lire M. Chevènement, ancien ministre de la recherche et de la technologie, puis de la recherche et de l’industrie (1981-1983), de l’éducation nationale (1984-1986), de la défense (1988-1991), de l’intérieur enfin (1997-2000), il s’agirait bien d’une corrélation : « L’ethnicisation des rapports sociaux n’a pas désolé outre mesure la gauche sociale-libérale et soi-disant “morale” : en développant un discours démagogique sur l’immigration, elle se rachetait à peu de frais de sa convergence de fond avec la droite libérale en matière de politique économique et sociale. »
Il est cependant bien des pays, les Etats-Unis de M. William Clinton (1993-2001) et le Royaume-Uni de M. Anthony Blair en particulier, où le libéralisme économique de la « gauche » s’adossa à un paternalisme répressif tiré du répertoire idéologique de la droite. Eprouver le devoir de se « racheter » quelque part ne serait-il pas alors le signe d’une pression sociale qui a interdit (grands mouvements de grève, solidarité avec les travailleurs immigrés) de rompre trop ouvertement avec certains ancrages ? La question n’est pour ainsi dire posée dans aucun de ces ouvrages, comme si, pour leurs auteurs, la politique de la gauche était circonscrite aux lieux de pouvoir, et ne se faisait jamais ni dans l’usine ni « dans la rue » (5).
En 1982, les socialistes espèrent
que la relance keynésienne sera sauvée par…
Ronald Reagan !
En matière de politique économique et commerciale, la « convergence » des socialistes et de la droite demeure, alors même que, selon M. Hollande, « le libéralisme n’est pas majoritaire en France. Scrutin après scrutin, la conclusion est la même ». Un retour sur les trois choix économiques majeurs de ces vingt-cinq dernières années – le maintien du franc dans le système monétaire européen (SME) en 1983, l’accélération de la marche vers l’euro à partir de 1989, enfin le pacte de stabilité en 1997 – permet d’essayer de dénouer ce paradoxe.
En 1981, la gauche choisit de combattre le chômage en augmentant la dépense publique ainsi que la consommation populaire, et en nationalisant les grands groupes industriels et financiers. M. Attali indique aujourd’hui que, si Mitterrand « avait voulu aller si vite à l’automne 1981, c’est parce qu’il ne pensait pas vivre au-delà de quelques mois ». Quoi qu’il en soit, la coïncidence de la relance en France avec un appareil productif délabré, d’une monnaie nationale surévaluée et d’une récession à l’étranger provoqua un déficit de la balance commerciale important – quoique proportionnellement inférieur de moitié à celui des Etats-Unis aujourd’hui (6)…
Depuis plus de vingt ans, le discours dominant associe à la fois la célébration de ceux qui défendirent le « franc fort » (dont MM. Michel Camdessus et Jean-Claude Trichet, qui furent successivement directeurs du Trésor), une critique méprisante de la politique keynésienne et volontariste de 1981 et la vitupération adressée aux analphabètes économiques qui auraient imposé à la gauche un programme irréaliste avant, lorsqu’il échoua, de proposer une « autre politique » plus absurde encore. Dès lors que ces derniers furent, en mars 1983, taxés d’être des « Albanais » partisans de l’autarcie et nostalgiques du Gosplan, autant rappeler les noms de quelques-uns de ces bolcheviks : Jean Riboud, président-directeur général de Schlumberger, Jean-Jacques Servan-Schreiber, ancien ministre de M. Valéry Giscard d’Estaing, Bérégovoy, MM. Fabius et Dumas…
Les livres des apôtres les plus fervents du virage libéral de 1983 permettent à présent de relativiser sur plusieurs points importants le conte pour enfants qui, depuis plus de vingt ans, tient lieu de vérité historique. Ainsi, M. Rocard confirme qu’il fallait laisser baisser la monnaie en mai 1981 : « Le jour de l’installation du président, j’avais plaidé pour une dévaluation de 15 % (…). Pour ne l’avoir pas fait, nous avons dû dévaluer trois fois de suite, le 4 octobre 1981, le 12 juin 1982 et le 21 mars 1983, chaque fois de 8 à 10 % si l’on cumule la dévaluation du franc et la réévaluation du mark. »
De son côté, analysant l’échec du programme de relance de 1981-1982, M. Delors estime qu’« on ne peut expliquer cette période en invoquant la seule générosité – ou prodigalité – de la gauche, comme on le fait souvent ». Et il précise : « Comme nous avions une croissance stimulée par une demande intérieure plus forte que celle des pays voisins, nous attirions les importations. Il en aurait été différemment si notre appareil de production avait été capable de répondre. Mais ce n’était pas le cas, pour une raison simple : pendant les années qui ont précédé la venue de la gauche au pouvoir, l’investissement productif avait insuffisamment progressé. (…) J’ajoute que les chefs d’entreprise n’aimaient pas ce changement de gouvernement. Quand on n’a pas confiance, on n’investit pas. »
Erreur des nationalisations, alors ? Cette fois, c’est M. Attali qui se rebiffe. Même si on doit accueillir les propos de l’ancien conseiller à l’Elysée avec méfiance – ne va-t-il pas jusqu’à nier, plusieurs fois, l’existence d’un virage de la rigueur en 1983 ? –, ceux qui suivent sont difficilement discutables : « Hormis la CGE (Compagnie générale des eaux), Saint-Gobain et deux ou trois banques, les entreprises concernées [par les nationalisations de 1982] se révélèrent en situation de quasi-faillite. (…) Si Valéry Giscard d’Estaing avait été réélu, la plupart d’entre elles auraient sans doute dû être démantelées ou vendues par morceaux à l’étranger. » M. Delors n’écrit pas autre chose : « Plus tard, lorsqu’on privatisera ces entreprises, l’Etat y gagnera. Il les revendra plus cher qu’il ne les avait acquises parce que, entre-temps, lui-même avait joué son rôle d’actionnaire. Je reste convaincu que les nationalisations ont permis de moderniser et d’adapter l’appareil productif et industriel français. »
Une politique exagérément monétariste et « sabotée » par des patrons peu disposés à favoriser la gauche ; des nationalisations « réussies », y compris en termes de finances publiques, y compris pour les actionnaires (trop) largement indemnisés en 1982 : de tels bémols maltraitent un peu la partition des vérités officielles. M. Mauroy y ajoute une note facétieuse en confirmant que, pour sauver une relance keynésienne menacée par les déficits extérieurs, Mitterrand espéra l’appui de… Ronald Reagan et de Mme Margaret Thatcher ! Lors du sommet de Versailles des pays industrialisés (juin 1982), le chef de l’Etat imagina en effet que « les grands leaders du monde accepteraient de se replacer dans la perspective d’une croissance concertée qui romprait l’isolement économique de notre pays. (…) François Mitterrand comptait sur Margaret Thatcher, avec qui il avait établi des rapports cordiaux, notamment en affirmant la solidarité de la France avec la Grande-Bretagne à l’occasion de la guerre des Malouines. En Allemagne, les sociaux-démocrates étaient au pouvoir et il estimait pouvoir convaincre Helmut Schmidt. Quant au président américain, ses choix ultralibéraux n’étaient pas encore aveuglants ».
Décidément, Mitterrand avait la vue basse… En tout cas, sa pression en faveur d’une relance « concertée » « se conclut par un flop retentissant ». L’échec fut l’antichambre des renoncements qui allaient suivre. Moins d’un an plus tard, le virage de la rigueur permettait à Mitterrand, selon M. Attali, de « provoquer une crise pour “purger”, disait-il une utopie ».
Mais ce genre de cynisme n’explique pas tout. Comme le souligne M. Dumas, « l’atlantisme de François Mitterrand est fervent », au point qu’en mars 1983 le président français attend de ses alliés occidentaux « une égale solidarité dans le domaine économique ». Il sera d’autant plus « déçu » que, deux mois plus tôt, il avait prononcé son « discours du Bundestag » (20 janvier 1983) approuvant la décision de l’Allemagne de déployer sur son sol des missiles américains de moyenne portée. M. Attali, qui ne déteste jamais s’attribuer un rôle important, précise alors : « Ce discours m’aida beaucoup, dans les semaines qui suivirent, à plaider auprès de lui contre le flottement du franc qui eût été incompatible avec une telle manifestation de solidarité franco-allemande (7). » La double inflexion, atlantiste et européenne, ne fut plus remise en cause. Elle conforta, selon M. Chevènement, le pouvoir de la « petite technostructure, sociale-libérale avant l’heure, qui attendait et préparait le moment d’un retournement de politique » (lire « Une nouvelle aristocratie née après 1981 »).
Ensuite, lancé par M. Delors, devenu en 1984 président de la commission européenne, ce fut, en février 1986, la signature de l’Acte unique européen. Le « traité favori » de M. Delors organise un « espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée » (article 7-A). Mitterrand en conclut que « prendre au profit » est devenu « inapplicable, car, quand les frontières sont fermées, il n’y a pas beaucoup de profit, et, quand elles sont ouvertes, les profits quittent les endroits inhospitaliers ». « C’est, proteste M. Chevènement, au moment où les économies européennes sont confrontées à la concurrence des pays à bas salaires que le projet d’union monétaire va leur enlever la seule soupape de sécurité dont elles disposaient : la liberté d’ajuster librement la parité de leur monnaie. »
La naissance de l’euro suivra. Là encore, l’accélération européenne, sans harmonisation préalable de la fiscalité de l’épargne, découle de considérations stratégiques. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, Mitterrand voulait en effet éviter que l’Allemagne soit distraite de la dynamique communautaire par le souci qu’elle avait de sa propre réunification. Or, précise M. Moscovici, « pour que l’Allemagne renonce à son mark, à cette orgueilleuse souveraineté monétaire, il fallait pour elle que la France se rallie, de façon définitive, à ses disciplines et à la sacro-sainte indépendance de la Banque centrale ». L’ancien ministre des affaires européennes du gouvernement Jospin concède que cette orientation fut « très coûteuse en termes économiques et sociaux ». La France y gagna en effet un million de chômeurs supplémentaires.
Rien de tel au temps de la « gauche plurielle ». En partie grâce à une monnaie qui cesse d’être surévaluée (l’euro perd près de 25 % par rapport au dollar entre 1999 et 2002), le gouvernement Jospin bénéficie d’une conjoncture économique favorable, qui soutient la création d’emplois. L’humiliation électorale du 21 avril 2002 n’en est que plus rude. M. Jospin y voit une « aberration » tant il estime que « la période 1997-2002 a été bonne pour la France : une croissance soutenue, un chômage baissant très fortement, les finances publiques redressées, des réformes sociales et sociétales menées à bien dans un climat de confiance et d’optimisme relatif ».
Cette fois, au demeurant, la gauche et le centre gauche gouvernaient la plupart des Etats de l’Union, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et (jusqu’en 2000) l’Italie. Néanmoins, le « capitalisme dur » (formule de M. Jospin en 1997) ne fut jamais remis en cause dans les cénacles européens (8). Pourquoi ? L’explication qu’apporte M. Moscovici rappelle quelques-uns des termes du débat de 1983 sur le maintien ou non du franc dans le SME : « Le traité d’Amsterdam avait été négocié – fort mal – avant notre arrivée aux responsabilités. Il comportait de nombreux défauts – et d’abord un contenu social très insuffisant (…). Le nouveau gouvernement aurait pu légitimement ne pas l’approuver. Nous eûmes, sur cette question, des discussions serrées rassemblant, autour de Lionel Jospin, Hubert Védrine, Dominique Strauss-Kahn et moi-même. Le traité n’était pas bon, et nous le savions. Nous aurions volontiers refusé de le signer, ou à tout le moins demandé de reprendre sa négociation. Ce ne fut pas notre choix final. Car nous étions confrontés, avec Jacques Chirac à l’Elysée, à la menace d’une triple crise. Crise franco-allemande (…). Crise avec les marchés financiers, dont les opérateurs souhaitaient l’adoption de ce traité avant la décision de passer à l’euro. J’ai éprouvé moi-même leur puissance (…). Crise de cohabitation enfin. » Une fois encore, un petit groupe décida ; une fois encore, il préserva la gauche d’une « crise avec les marchés financiers »…
Lionel Jospin veut
« continuer à faire évoluer le capitalisme,
mais progressivement »
Les socialistes peuvent-ils conduire un jour une politique plus offensive ? L’ouvrage de M. Jospin, qui, au passage, se réjouit du « succès » des « ouvertures de capital pour permettre des alliances industrielles internationales, dans le cas d’Airbus-EADS », suggère la réponse. Car, en le lisant, on comprend que ce n’est pas seulement l’Europe (libérale, y compris quand elle est gouvernée « à gauche ») ni même la mondialisation qui incitent les socialistes à n’ambitionner que de « continuer à faire évoluer le capitalisme, mais progressivement ». C’est également la transformation de la société, en particulier l’éclatement de la classe ouvrière, qui aurait mis à mort tout projet de « rupture avec le capitalisme ».
Peut-être un peu désemparé de n’avoir obtenu que 13 % des suffrages ouvriers en 2002, M. Jospin explique : « La gauche qui ne gouverne pas enjoint souvent à celle qui gouverne d’écouter les milieux populaires. Or il n’est pas toujours aisé d’interpréter la voix de milieux hétérogènes. Entre les employés, les ouvriers au smic, les ouvriers qualifiés, les petits artisans et commerçants, les agriculteurs pauvres, les chômeurs ou tous ceux qui n’ont pour vivre que des minima sociaux, les attentes diffèrent. Il n’est pas facile de mener une politique économique et sociale favorable à toutes ces catégories à la fois. Nous en avons fait l’expérience entre 1997 et 2002. (…) Nous avons autant que possible essayé d’équilibrer nos choix pour ne négliger personne. »
Est-ce parce qu’un tel projet lui paraît trop « équilibré » ou trop peu ambitieux que M. Hollande adjure la gauche radicale, communiste en particulier, de « ne pas laisser la social-démocratie seule avec elle-même » ? Il redoute, dans le cas contraire, que « ces deux fleuves ne se rejoignent plus, y compris à l’occasion des confluences électorales ».
Par Serge Halimi, avril 2007
Bibliographie
Roland Dumas, Affaires étrangères 1, 1981-1988, Fayard, Paris, 2007, 438 pages, 24 euros.
Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, Paris, 2006, 447 pages, 22 euros.
François Hollande, Devoirs de vérité, Stock, Paris, 2006, 295 pages, 18 euros.
Michel Rocard, Si la gauche savait, Robert Laffont, Paris, 2005, 373 pages, 20 euros.
Lionel Jospin, Le Monde comme je le vois, Gallimard, Paris, 2005, 328 pages, 20 euros.
Jean-Pierre Chevènement, Défis républicains, Fayard, Paris, 2004, 648 pages, 25 euros.
Jacques Delors, Mémoires, Plon, Paris, 2004, 511 pages, 25 euros.
Pierre Moscovici, Un an après, Flammarion, Paris, 2003, 418 pages, 20,90 euros.
Pierre Mauroy, Mémoires, Plon, Paris, 2003, 506 pages, 24 euros.
Serge Halimi
Soutenez-nous !
La défense de notre singularité et la poursuite de notre développement dépendent de votre mobilisation financière à nos côtés.
Faites un donAbonnez-vous
(1) « Observer le PS c’est rencontrer un univers peu fraternel et souvent impitoyable, d’une grande violence symbolique, où tend à dominer, derrière les codes de la “camaraderie’’ militante, une économie morale du cynisme », notent Rémi Lefebvre et Frédéric Sawicki dans l’excellente étude, La société des socialistes, qu’ils consacrent à ce parti (Editions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2006).
(2) Selon le New York Times du 8 mars 2007, M. Bayrou a déclaré : « Je suis un démocrate. Je suis un clintonien. Je suis un homme de la troisième voie. » Il a également fait savoir que, s’il pouvait voter aux Etats-Unis en 2008, il aimerait le faire pour M. Albert Gore.
(3) Lire Quand la gauche essayait, Arléa, Paris, 2000.
(4) « Fort de son appui à Mitterrand à Metz, il ramasse la mise, rappelle M. Delors. Voilà donc le programme socialiste entre les mains de Chevènement et mon texte au panier. »
(5) M. Hollande note cependant : « En 1997, le succès surprise du PS à l’occasion de la dissolution ratée de Jacques Chirac est largement le fruit de la mobilisation de 1995 contre le “plan Juppé”. »
(6) Le déficit extérieur français atteint 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 1982. Celui des Etats-Unis est en 2006 de 6,6 % du PIB.
(7) Selon M. Rocard, en mars 1983, M. Attali était plus « ambigu » qu’il ne le prétend : « Il a essayé d’accréditer, après coup, l’opinion selon laquelle il n’avait pas été très favorable à l’idée [de la sortie du SME], mais je n’en suis qu’à moitié sûr. »
(8) Cf. « Quand la gauche renonçait au nom de l’Europe », Le Monde diplomatique, juin 2005.
[Facebook_Comments_Widget title= » » appId= »331162078124″ href= » » numPosts= »5″ width= »470″ color= »light » code= »html5″]


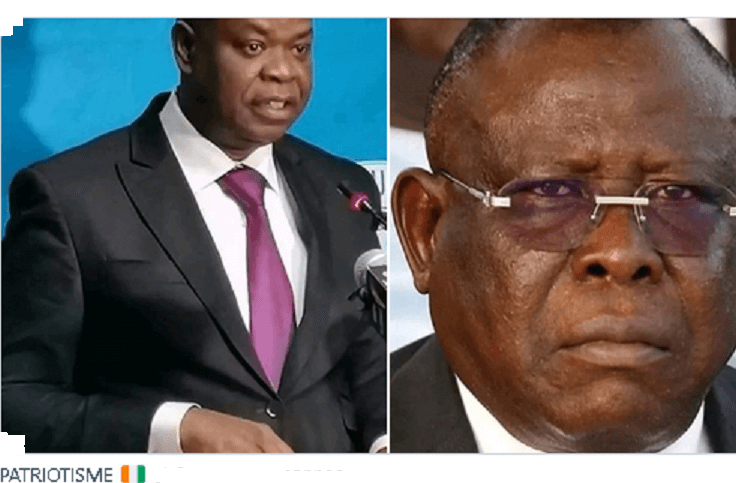




Commentaires Facebook