Le grand débat | leMonde.fr
par Philippe Bernard (Le grand débat)
Les « révélations » de Robert Bourgi sur le financement de responsables politiques français par des chefs d’Etat africains remettent en lumière les relations troubles de la France avec ses ex-colonies. Tenez-vous pour un fait cette « corruption mutuelle » et, dans ce cas, comment en expliquez-vous la persistance cinquante ans après les indépendances ?
Les révélations de M. Bourgi n’en sont point, car ces pratiques étaient connues. Le fait que l’un des acteurs importants de ces marchandages prenne la parole en public maintenant montre que cet anachronisme que l’on a appelé la Françafrique est condamné à terme. Aujourd’hui, l’important est de porter nos regards sur ce qui vient, sur les dynamiques neuves. La France n’est plus le soleil de l’Afrique, car elle se trouve en compétition avec des acteurs nouveaux comme la Chine, le Brésil et l’Inde. Elle n’en est même plus le miroir et je crois que cela est bon. En même temps, un tissu de liens humains s’est constitué au fil des siècles entre la France et l’Afrique. Il faut investir dans ces relations humaines pour faire naître des solidarités neuves qui dépassent les rapports entre Etats.
Comment expliquez-vous que beaucoup de gens sur le continent continuent de penser que leur avenir se joue à Paris ?
Beaucoup d’Africains le croient car ils continuent de lire l’action de la France en Afrique à travers le prisme des philosophies autochtones. L’histoire y est considérée comme une modalité de la sorcellerie où le sujet s’identifie comme victime de forces obscures, extérieures, qui lui échappent. A cet héritage local lié à l’imaginaire, s’ajoute une expérience historique forgée à l’époque coloniale et prolongée par les pratiques néocoloniales : des interventions armées, le soutien actif à des dictatures corrompues, et la difficulté qu’ont éprouvée tous les gouvernements français, de droite comme de gauche, à s’allier à des forces d’émancipation.
Pourquoi la gauche a-t-elle échoué à promouvoir la démocratie en Afrique ?
Au fond, la gauche française, hormis le PCF à l’époque coloniale, a toujours partagé avec la droite un regard sur l’Afrique et les Africains fondé sur l’idée que les sociétés africaines sont régies par des règles différentes des nôtres. La gauche a souvent porté sur le continent un regard marqué par le paternalisme et un excès de bonne conscience. Elle a donc peut-être été un peu plus autiste que la droite, alors même que la recherche académique française n’a pas arrêté de montrer les transformations des sociétés africaines.
Vous avez critiqué l’intervention française en Côte d’Ivoire, justifiée officiellement par la nécessité de faire respecter le résultat d’une élection et de stopper les violences. Pensez-vous qu’une guerre civile soit préférable à une intervention étrangère ?
Les deux options constituent des pis-aller. Le défi historique auquel fait face le continent africain consiste à pacifier les formes de la lutte politique, à découpler le politique et la guerre. Tant que cela ne sera pas accompli, le nombre de conflits sanglants ne diminuera point.
L’Afrique doit aussi s’astreindre à inventer par elle-même, à partir de ses ressources historiques et intellectuelles, un modèle de démocratie qui réponde à la complexité anthropologique de ses sociétés, et qui ne soit pas une greffe imposée par les bailleurs de fonds ou des armées étrangères. Ceci exige un travail lent, pénible, méthodique et discipliné que personne n’est prêt à envisager pour le moment. Enfin, l’absence d’une puissance hégémonique africaine capable de s’imposer avec d’autres sur le théâtre africain fait que le continent reste comme le ventre mou du monde qui attise la volonté des puissances étrangères d’y intervenir.
Après le « printemps arabe », un « printemps africain » est-il possible ?
Non, aucun régime africain ne court ce risque. Les conditions qui ont conduit aux événements du printemps n’existent nulle part. Au sud du Sahara, les classes moyennes existent depuis cinquante ans tout au plus et n’ont ni le recul historique des égyptiennes, ni le niveau de professionnalisation des tunisiennes.
Vous avez écrit qu’avec l’immigration, « la France récolte ce qu’elle a semé avec sa politique africaine ». De quelle façon le passé colonial pèse-t-il sur la politique française d’immigration ?
Il faut dédramatiser : la France n’est plus le pôle privilégié de l’immigration africaine en direction de l’Occident. Le nombre d’Africains qui ont pour objectif d’aller en France est très petit et va décroissant. Les discours français sur l’immigration africaine relèvent du fantasme. Ils sont liés à la période particulière que nous vivons, marquée par une rebalkanisation du monde, une redistribution planétaire très inégale des possibilités de mouvement, la construction de murs et la militarisation des frontières. Cela n’est pas typiquement français, mais la France s’exprime en mettant la peur de l’immigré au service d’une politique raciste, en attisant le fantasme d’une France sans étranger, une idée qui est contraire à son histoire.
La droite comme la gauche s’alarment de « l’échec de l’intégration » des descendants d’Africains. Qu’en pensez-vous ?
Il n’est pas vrai de dire que les descendants d’immigrés africains ne se sont pas intégrés. Les conflits, les luttes et les débats en cours montrent que l’intégration est en marche. Mon regard sur la France est optimiste. La réalité, c’est qu’elle est aux prises avec son histoire, elle en train de s’autoproduire sur un mode inédit et cela désempare beaucoup de gens. D’où tout ce bruit autour des questions d’intégration et d’assimilation.
Pourtant, vous avez souvent dénoncé l’incapacité de la France à assumer son passé colonial !
Je l’ai pensé, mais en réalité, le débat est nourri : il n’y a pas de refoulement, mais un énorme défoulement après une période d’aphasie. Il faut passer du défoulement à une critique exigeante du passé, qui ouvre des chemins d’avenir et n’empêche pas la France d’effectuer les nouveaux voyages planétaires de la pensée.
Vous critiquez une France incapable d’assumer la fierté de sa diversité et en voie de provincialisation. N’est-ce pas contradictoire ?
Non : il y a un décalage entre le dynamisme des processus sociaux en cours, les multiples exemples de convivialité dans les quartiers, dans les arts, et le discours public qui est porté sur eux. Cette vie citoyenne conviviale pourrait servir de base pour imaginer une France qui, au lieu d’avoir peur, serait ouverte parce qu’elle saurait d’où elle vient et ce qu’elle est.
Pourquoi ce discours est-il si peu porté politiquement ?
La France est grincheuse, elle aime le persiflage. C’est un pays où pour exister, il faut critiquer. Où un discours optimiste risque d’être pris pour de la naïveté.
Le facteur racial a été déterminant, selon vous, dans notre histoire coloniale et vous militez pour que sa persistance dans la société soit reconnue. Cela ne risque-t-il pas d’entretenir un esprit victimaire peu propice à l’intégration ?
Aujourd’hui, on dit aux immigrés africains et à leurs enfants : « Vous devez être comme nous. Mais, comme vous êtes vraiment différents, nous savons très bien que vous n’y parviendrez pas et que vous ne pourrez donc jamais vous intégrer. » Il faut réintroduire la race si l’on veut sortir de ces impasses qui bloquent toute discussion sur les transformations de l’identité française et la capacité du modèle français à élargir notre compréhension de la démocratie. Cela n’a rien à voir ni avec le « communautarisme » ni avec cette hypocrisie qui consiste à faire comme s’il n’y avait pas une histoire à assumer et à transcender. Une histoire où la race a occupé des fonctions symboliques, politiques et économiques à travers l’esclavage et la colonisation. Il ne s’agit pas de faire repentance, mais de sortir de cette espèce de bonne conscience bête qui fait que l’on ne sait même plus qui l’on est à force de dénégations.
Pourquoi enfermer les gens dans des catégories si l’objectif final est de les dépasser ?
Parce qu’il faut redresser un certain nombre d’inégalités que la race a servi à constituer historiquement. Il faut que la représentation politique soit à l’image de la convivialité qui existe dans la société. Il faut faire en sorte que la non-diversité devienne un anachronisme.
Vous appelez la République à reconnaître les divisions raciales alors que vous affirmez que le cosmopolitisme est l’avenir de l’humanité !
Je me situe dans une tradition d’origine africaine qui a toujours pensé que la différence en soi ne signifie pas grand-chose mais aussi que la reconnaissance de la différence est un moment significatif, stratégique, dans le projet plus large d’un Senghor ou d’un Glissant, d’une « épiphanie des nations ». L’humanité sera riche de l’ensemble de ses singularités. Elle sera appauvrie si ces singularités lui sont amputées. Je ne suis pas un militant de la différence, je suis pour une politique du semblable et de l’en-commun, si tant est que le monde que nous habitons appartienne à tous.
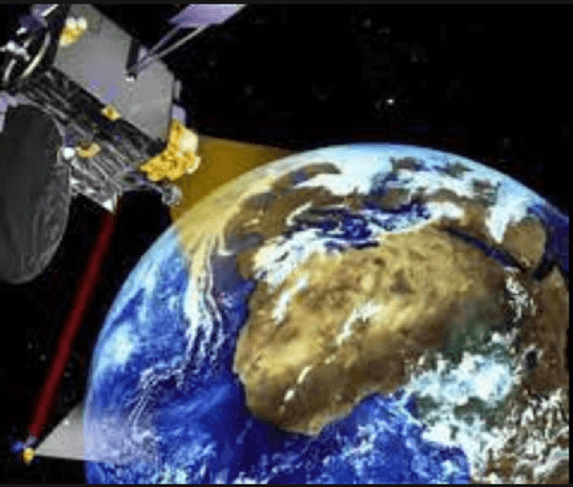

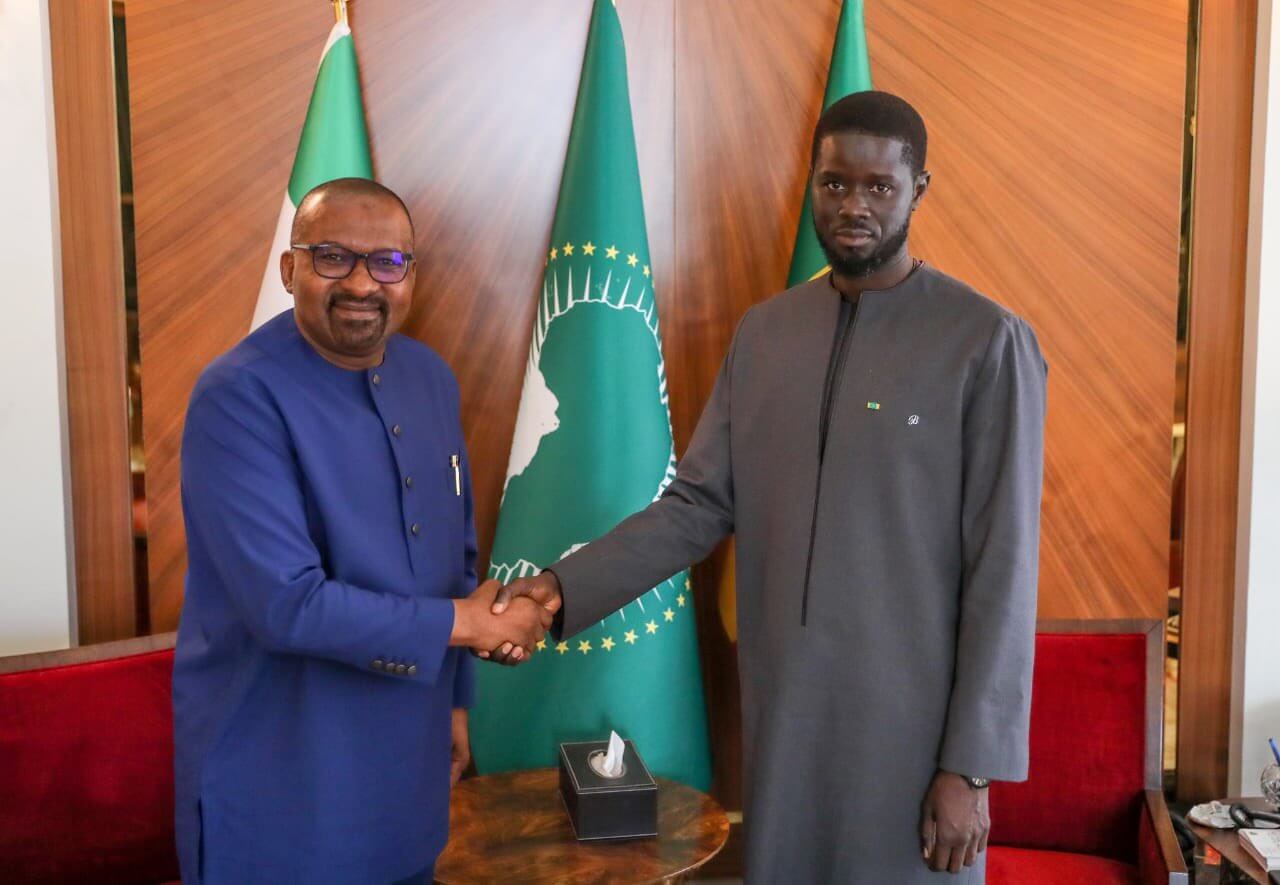



Les commentaires sont fermés.